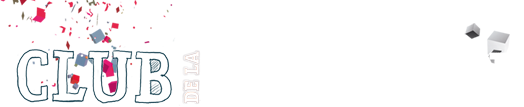«J’aimerais vous dire quelque chose…» – à peine ces mots prononcés, Daniel* met la main sur les yeux et se détourne en disant: «Non, c’est trop difficile.» Il s’éloigne, puis revient, et tente à nouveau de parler. Cette fois-ci, la main sur la gorge, il murmure: «Je ne peux pas…», et s’éloigne à nouveau. Finalement, après plusieurs tentatives avortées, scandées par autant d’allées et venues, il réussit à déclarer: «Vous savez, il n’y a pas de catastrophe plus terrible que la folie, car quand elle frappe, on ne peut plus jamais en sortir.»
Pourtant, Daniel prend part à une réunion du comité de rédaction de La Gazette, une publication faite par quelques soignants, un ou deux bénévoles, et surtout des patients venus de trois établissements de psychiatrie institutionnelle (lire ci-dessous) de la région de Blois-Saumery, La Borde et la Chesnaie. Daniel et tous les autres patients sont des psychotiques, ce qu’on appelle des «fous». Contrairement à la plupart des malades d’institutions psychiatriques publiques ou privées, qui, eux, sont soignés en milieu fermé ou abandonnés à eux-mêmes et souvent à la rue, Daniel et ses compagnons vivent et évoluent en milieu ouvert, tout en étant constamment accompagnés dans les activités qu’ils ont choisies.
Dans ce milieu de la psychiatrie de plus en plus homogène et contrôlé (lire ), ces «fous» sont bien conscients des menaces qui pèsent sur leurs cliniques pas comme les autres. Le sujet apparaît spontanément: «Il y a le problème des normes et des protocoles…» Un silence tranquille se fait. Puis quelqu’un reprend: «Le partage des tâches est au cœur de ce qu’on fait – notamment à la cuisine. Mais avec les normes, même si on peut encore sortir dans le jardin pour aller manger les mûres et les pommes, on n’a plus le droit de les récolter pour les cuisiner pour la collectivité.» Philippe*, qui jusque-là est resté silencieux en regardant ses pieds, lance tout à coup: «Les gens pensent que la maladie psychique, c’est dangereux.» Henri* se lève, se rassoit, puis se relève: «Moi, j’ai peur du monde, j’ai peur d’être entouré de gens inconnus. Il y a des médicaments qui m’aident. Mais quand j’ai trop peur, je dois aller me coucher» – il quitte la pièce pour aller s’allonger dans une des chambres voisines.
La réunion du comité de rédaction touche à sa fin: avant que tout le monde ne reparte, Vincent*, soigné à la Chesnaie et associé au cours d’expression théâtrale de La Borde, sort un violon de son étui et joue un très beau morceau de musique baroque.
Passeport pour la Chesnaie
La maladie mentale, c’est-à-dire la psychose, et les soins qu’elle requiert sont-ils un parcours, un véritable voyage?
C’est bien en tout cas un passeport que l’équipe de soignants de la Chesnaie remet à tout nouveau patient: «Bienvenue» y est le premier mot sur la première page. Suit un résumé succinct de la situation: «Puisque l’hospitalisation vous est nécessaire quelque temps, il importe qu’elle soit elle-même source de soulagement et que vous preniez part, notamment par l’intermédiaire du Club et de l’organisation que vous découvrirez, aux réalisations et aux responsabilités qui font de la maison ce qu’elle est.» Signée par le médecin-directeur, le Dr Jean-Louis Place, cette entrée en matière est suivie du mode d’emploi de la vie à la Chesnaie – une vie issue de l’autogestion mise en pratique à La Borde par le Dr Jean Oury, et avant lui, à Saint-Alban par François Tosquelles (lire ci-dessous).
Contrat rémunéré
L’implication des patients dans le fonctionnement même de l’institution se fait grâce au contrat: tous les patients ont accepté de s’engager dans des ateliers qu’ils ont choisis, ainsi que de collaborer avec les soignants aux différentes tâches utiles à la vie collective de la Chesnaie contre une rémunération minimum.
La cuisine est certainement l’endroit le plus emblématique: matin, midi et soir, des repas connus pour leur qualité sont élaborés et cuisinés par un petit groupe de soignants et de patients pour tous ceux qui viennent à la grande salle de restaurant – ici, pas de nourriture industrielle, mais des recettes et des saveurs qui font partie de la volonté d’humaniser la maladie mentale.
Dans le passeport, une carte permet de repérer les multiples bâtiments où la clinique accueille patients et soignants – et de localiser le Club de la Chesnaie, cœur battant des lieux.
Le Club thérapeutique est l’association (loi de 1901) qui fait le pont entre la clinique et le monde extérieur en assurant la gestion de tous les ateliers suivis par les patients (arts plastiques, musique, couture, mosaïque, poésie), ainsi que des lieux de vie associatifs qui accueillent les personnes suivies en hôpital de jour. Le Club assume aussi la rémunération des contrats qui engagent la responsabilité des patients dans la vie collective de la Chesnaie.
Interface avec l’extérieur
Cette association a ses quartiers dans le Boissier – un bâtiment de bois et matériaux de récupération construit durant les années 1980 par des architectes stagiaires et des patients de la clinique. Aujourd’hui classé monument historique, le Boissier est un lieu où toute la journée, on peut venir se prendre un petit café, se retrouver, s’informer et débattre des activités du Club.
Sur un banc, Jacqueline*, une ancienne patiente résidente, aujourd’hui suivie en hôpital de jour, aime accueillir tout nouveau visiteur: «Ici, on a le temps de se reconstruire et de se soigner en profondeur. Le Club fait l’interface entre la clinique et le monde extérieur: il y a une salle de concert, on y organise des loisirs, des activités, il y a aussi une réunion tous les mardis pour faire le point.» Françoise* vient saluer Jacqueline: elle fait partie de l’équipe qui s’occupe du bar du Boissier. Elle aussi est une patiente de la Chesnaie, également en hôpital de jour. Poète, elle a déjà plusieurs recueils à son actif. Au comptoir, aux côtés d’autres personnes – des patients résidents et des soignants –, elle tend cafés et chocolats chauds en ce matin pluvieux et frais.
Aujourd’hui, la réunion du mardi après-midi rassemble sur des gradins en bois patients et moniteurs – le nom des soignants infirmiers. On partage idées et suggestions pour des sorties, voire un séjour estival au bord de la mer. On fait aussi le point sur des événements culturels les plus récents organisés par le Club. La sortie au Festival de musique de Bourges a satisfait ceux qui y ont pris part, dont Christian*: «Le groupe de funk-électro était très bien. Ils sont de la région. On a pu voir des bribes du concert.» Valérie* se lève, très sérieuse. Elle aussi faisait partie de cette sortie: «Je déconseille de prendre de la bière parce qu’elle n’est pas bonne et donne mal à la tête.» Christian* nuance les choses: «C’est ton opinion.» Imperturbable, Valérie* précise: «Je vous informe», et se rassoit. Puis c’est au tour d’Ophélie, jeune stagiaire qui vient d’arriver, de présenter son projet: «Je voudrais mettre en place un atelier de jeux solidaires qui fonctionnent sur le contraire de la compétition. Là, il faut s’aider pour gagner, car tout le monde partage le même but. Il faut gagner tous ensemble.»
Après la fin de la réunion du Club au Boissier, patients et moniteurs se dispersent vers d’autres activités et occupations. Il est aussi temps de rejoindre Maria et une demi-douzaine d’autres stagiaires et moniteurs au séminaire que le Dr Claude Jeangirard donne une fois par semaine à ceux qui désirent y prendre part.
L’institution protectrice
Fondateur de la clinique de la Chesnaie dont il a acquis le terrain et les bâtiments en 1956, le Dr Jeangirard vit dans une maison construite à côté du Château – le bâtiment principal du XVIIIe siècle qui abrite la plupart des chambres ainsi que les cuisines et le restaurant. Il a pris sa retraite il y a déjà de longues années et maintient dialogues et débats.
Maria, arrivée il y a quarante-huit heures à peine, rentre dans le vif du sujet: «Qu’est-ce qui est réellement thérapeutique à la Chesnaie?» Assis en face d’elle dans un grand fauteuil, le docteur répond: «Dans l’état actuel des réflexions, c’est l’enveloppe. […] L’institution devient une personne qui doit être une protection radicale contre le monde. […] Un psychotique, un schizophrène, n’a pas de sens de son corps, il n’a pas de sens de l’espace et il faut donc lui fournir un espace qui ne soit pas dangereux. […] Le psychotique a aussi perdu la notion du temps, de la continuité et de la logique des événements ayant mené à une catastrophe – et c’est là où le schizophrène remplace l’histoire vraie par une histoire fantastique, avec hallucinations et délires de persécution. […] Le psychotique est un auteur dramatique qui ne respecte pas les trois unités [de lieu, de temps et d’action]. Une clinique, c’est un théâtre, où on est tous acteurs…»
Réussir à donner à des patients psychotiques un sentiment de sécurité à partir d’un lieu ouvert est une tâche de longue haleine et de chaque instant. Cela demande des moyens humains sans lesquels rien ne pourrait se faire: la centaine de patients résidant à la Chesnaie sont accompagnés et suivis par environ quatre-vingts personnes. Camille, qui travaille ici depuis plusieurs années, insiste sur le fait que la liberté de mouvement des patients est totalement compatible avec un vrai suivi et un encadrement humain: «Quand on ne connaît pas la Chesnaie, on ne s’en rend pas compte parce qu’il n’y a pas de signe extérieur, de blouse blanche, qui nous différencient les uns des autres. Mais en fait tout le personnel collabore et communique tout le temps afin de savoir constamment où sont chacun de nos patients. Les gens du système hospitalier n’arrivent pas à comprendre cela – mais nous tous, moniteurs et personnel soignant en général, nous connaissons tous nos patients et nous savons où ils se trouvent, afin qu’ils ne soient jamais en situation de risques pour eux-mêmes.»
En fin de journée, certains moniteurs en horaires décalés ainsi que les stagiaires et les visiteurs occasionnels se retrouvent aux Wagons: ce havre de paix est un assemblement architectural étonnant qui a immobilisé dans l’espace et le temps six anciens wagons de première classe datant de 1928 donnés par la SNCF. Tout le monde vient s’asseoir dans la petite cuisine qui leur est adjacente.
«La valeur humaine de la folie»
Leslie, jeune soignante, n’a pas aimé son travail dans le milieu hospitalier courant: «J’ai fait pas mal d’intérim en CHU1, et j’y ai vu pas mal de maltraitance. Alors j’ai choisi de venir ici: le système de polyvalence fait qu’on change de tâche tous les quatre mois. Ici, les soignants passent par toutes les fonctions: il n’y a pas de tâches plus nobles que d’autres, pas de hiérarchie. Tout se fait à partir d’un grand respect.»
En vertu d’un accord entre son école et la Chesnaie, Mathieu, lui, est sur le point de conclure ses études d’ostéopathie. Il termine trois semaines de stage, après quoi un autre étudiant de 6e année prendra sa relève: «Les patients sont des psychotiques. Je dois donc toujours essayer de savoir comment ils ressentent leurs corps. Il faut s’adapter à eux. J’ai essayé de rendre cela dynamique, de les encourager à parler afin qu’ils me disent ce qu’ils ressentent, de les amener à gérer au maximum leurs douleurs.» Mais n’est-ce pas trop différent des patients «normaux» qu’il traitera ensuite? Pour lui, c’est là tout l’intérêt: «Ce qui me plait ici, c’est que les psychotiques sont directs: ils disent ce qui va bien et ce qui ne va pas.»
Mathieu pose sa tasse de café sur la table, se lève, s’approche d’un grand panneau mural et désigne les innombrables petits mots et cartes postales laissés et envoyés par toutes celles et ceux que les Wagons ont accueillis pour traverser l’expérience de la Chesnaie – un voyage qui les a souvent convaincus d’y revenir travailler de façon plus permanente. Il pointe au hasard un des papiers, se penche et le lit à voix haute: «On sait qu’on doit y aller, mais après le séjour ici on ne veut pas partir: c’est une expérience humaine hors du commun. On retrouvera rarement cette cohésion et cette façon de nous demander tout le temps ce qu’on pense.» Une belle preuve de la persistance de l’esprit de François Tosquelles, qui jadis déclarait: «Sans la reconnaissance de la valeur humaine de la folie, c’est l’homme même qui disparaît.» I
*Tous les noms des patients ont été changés pour respecter leur vie privée.
• 1. Centre hospitalier universitaire.
Résistance et complémentarité
Normes, procédures, évaluations et traçabilité sont les outils de la mondialisation. Loin d’être cantonnés aux domaines industriels et techniques, ils sont appliqués à la médecine avec des législations constamment remaniées. Aujourd’hui, le recours à ces outils de gestion a tendance à prédominer dans les services de psychiatrie publics et privés. La bible de cette approche est le DSM nord-américain, ou manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux: les maladies mentales ne sont expliquées qu’en tant que troubles du comportement, aux origines strictement organiques, et auxquels correspondent des molécules à administrer aux patients, généralement confinés à leurs chambres durant le traitement.
«Derrière le DSM, il y a les neurosciences qui avancent main dans la main avec les lobbys pharmaceutiques. Le DSM donne la liste d’une multitude de symptômes vus de l’extérieur: aujourd’hui, on ne parle même plus de psychose, mais juste de troubles du comportement. Ainsi, on élude la structure de la personnalité et sa demande de soins, pour ne parler que de rééducation. Tout ceci correspond surtout au désir de se débarrasser de la psychanalyse, de la parole des patients, de leur histoire, de la compréhension de leurs vécus et de leurs ressentis», explique Brigitte Haie, psychologue à l’hôpital Bretonneau de Tours. Dans ce contexte, la psychiatrie institutionnelle qui fonctionne en lieux ouverts, avec une orientation psychanalytique assumée, est une forme de résistance à une pensée qui se voudrait unique.
Dans le bâtiment de l’Orangerie de la Chesnaie, où son bureau est à côté de la grande salle de l’atelier d’arts plastiques, le Dr Jean-Louis Place, directeur de la clinique, fait le point sur la question épineuse de ces normes qui envahissent toutes les activités: «Certaines sont tout à fait inadaptées. Par exemple, ce flacon de solution hydro-alcoolique que je suis obligé d’avoir dans mon bureau: c’est l’exemple d’une règle venue des maladies organiques et imposée à la maladie mentale.» En effet, il n’y a aucun besoin de se désinfecter les mains chaque fois qu’on va s’asseoir et écouter un patient. L’anecdote est révélatrice: «Ces normes sont imposées par des gens de plus en plus éloignés du terrain, pour qui tout doit être parfait et se plier totalement aux règles de la traçabilité. Les pratiques d’évaluation sont les seules qui comptent: il faut des traces écrites, des protocoles – mais du coup on en oublie les patients. Tout ceci est très éloigné du dialogue avec eux.»
Ces paroles et soins multiples qu’apporte la psychiatrie institutionnelle dans le contexte de la clinique privée de la Chesnaie coûtent-ils plus chers que les soins normés et standardisés, du secteur public? Bien au contraire, selon Jean-Louis Place: «Notre tarif journalier – remboursé par la Sécurité sociale et les mutuelles – est inférieur de plus de moitié à celui le plus bas pour une hospitalisation publique, soit environ 150 euros contre un minimum de 300 euros!»
Pour le Dr Place, il n’y a pas d’antagonisme entre la Chesnaie et les autres acteurs de la santé publique, mais une complémentarité utile. «Il y a des gens qui pensent que la psychiatrie institutionnelle ne vaut rien. Et dans l’autre extrême, on va trouver des personnes pour qui aucun salut n’existe hors de ce qui se fait ici! Mais avant tout, il est important de ne pas construire de murs entre les uns et les autres: pour cela, nous développons les partenariats, afin que beaucoup de personnes de l’extérieur passent par la Chesnaie – des stagiaires, des journalistes! Nous avons souvent des visites du secteur public et nous sommes en partenariat permanent avec eux, nous maintenons un dialogue constant!»
Ce partenariat est multiple: tous les patients de la Chesnaie viennent de l’hôpital public. Inversement, quand un patient passe par un état de crise aiguë, il est immédiatement transféré à l’hôpital de Blois, qui a les infrastructures appropriées pour prendre en charge ces situations ponctuelles et extrêmes. Une fois la situation stabilisée, le retour à la Chesnaie est possible. La psychiatrie institutionnelle et son approche de la maladie mentale rendent possible ce va-et-vient aux patients psychotiques, ainsi qu’un accueil de longue durée où la nature ouverte du lieu, la participation au quotidien et le dialogue constant sont aussi des soins de chaque instant.
La folie est une révolution permanente
Fille libertaire de la République espagnole, de Marx, de Freud, sœur de l’anticolonialisme: ce qu’on appelle depuis le début des années 1950 la psychiatrie institutionnelle s’inscrit dans les événements historiques et les courants de pensée les plus révolutionnaires du XXe siècle.
A l’origine, François Tosquelles, psychiatre catalan et républicain libertaire: le fascisme franquiste ne lui pardonnera jamais son travail sur les fronts de la guerre d’Espagne. Sitôt au pouvoir, le Caudillo le condamne à mort. Mais Tosquelles réussit à fuir en France. Il trouve tout à la fois refuge, accueil et travail à l’asile psychiatrique de Saint-Alban sur Limagnole, en Lozère. Entre-temps, la Deuxième Guerre mondiale s’est déclenchée: il n’y a pas de rationnements pour les malades mentaux, plus de trente mille d’entre eux vont mourir de faim dans toute la France. Mais pas à Saint-Alban: Tosquelles pratique l’autogestion et envoie les patients travailler dans les champs avec les paysans du village – tous les «fous» survivent, et même, vont remarquablement mieux car ils ne sont plus enfermés. Si le rapport d’habitude clivé entre hôpital et malades mentaux produit de la souffrance psychique, constate-t-il, à l’inverse, on produit du soin en modifiant l’institution, c’est-à-dire la relation entre soignants et soignés. La psychiatrie doit donc s’ouvrir sur la vie, l’art et la politique, et surtout rester proche des gens «normaux».
La révolution, à Saint-Alban, au milieu de la pauvreté et de la guerre, c’est donc de donner là, tout de suite, un véritable asile aux «fous», aux surréalistes et aux résistants qui vont se croiser, vivre ensemble, et créer. Le poète Paul Eluard en sera. En 1952, le grand militant anticolonialiste et psychiatre Frantz Fanon arrive à Saint-Alban. Deux ans plus tard, il s’en inspire quand il est nommé en pleine guerre d’Algérie à l’hôpital de Blida, où il met en œuvre la «sociothérapie». Là, Fanon approfondit sa réflexion sur le lien entre psychose et colonialisme, comme en témoigne son livre le plus connu, Les Damnés de la terre. Il démissionnera pour rejoindre le FLN et la révolution algérienne.
Durant ces même années 1950, le Dr Jean Oury fait essaimer la psychothérapie institutionnelle, d’abord à Saumery, puis à La Borde, dans la région de Blois. En 1956, dans les environs, son collègue, le Dr Claude Jeangirard, acquiert à son tour la Chesnaie. Aujourd’hui, cela fait plus de soixante ans que la psychiatrie institutionnelle rayonne tout à la fois par ces lieux uniques que sont ces trois cliniques, ainsi que par les nombreux médecins qui, à titre individuel, s’en inspirent pour continuer à donner sa place, en milieu hospitalier, à l’écoute de la parole des malades psychotiques.
Le Courrier